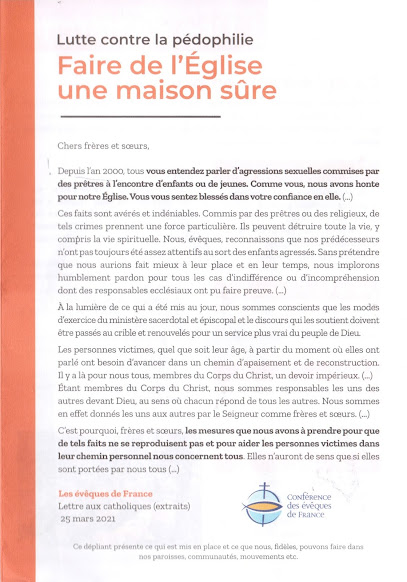La Semaine sainte pour les Nuls
Peut-on faire comprendre à quelqu’un qui ignorerait tout de la religion chrétienne – je doute que ce « tout » existe – ce que les chrétiens revivent et reçoivent pendant la Semaine sainte ? Chez les catholiques, branche importante du christianisme, cette semaine est marquée par plusieurs cérémonies qui sont autant de jalons d’une marche, renouvelée chaque année, vers le dimanche de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ, sommet de la vie chrétienne.
Louange de buis
Le prologue de cette Semaine, ou son acte zéro, est le dimanche des Rameaux, qui commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, saluée de palmes (en France, c’est souvent du buis) et d’hosannas joyeux. Mais la liturgie de ce dimanche pose aussi sur le seuil de cette semaine le long et douloureux récit de la Passion, comme un sommaire de ce qui va se dérouler pendant les jours suivants. Sans doute à cause de ces buis, qui sont bénis au début de la messe des Rameaux et que les fidèles, au nom d’une tradition multiséculaire, tiennent à rapporter chez eux pour les placer sur un crucifix ou près d’une photo de famille, voire sur une tombe, ce dimanche-là reste l’un des plus fréquentés de l’année, y compris par celleux qui ne mettent jamais les pieds à l’église le reste du temps. Moi qui ai vu mes grands-mères et mère honorer cette tradition, j’y ai rarement dérogé.
De l'huile à l'onction
Le premier acte se joue le mardi. Il est éminemment clérical. L’évêque rassemble autour de lui, dans sa cathédrale - à Orléans, Sainte-Croix - les prêtres de son diocèse, son « presbyterium », pour une messe dite « chrismale » parce qu’y sont bénites ou consacrées les huiles destinées à l’administration de différents sacrements tout au long de l’année, qui s’accompagnent chacun d’une onction, une croix huileuse tracée sur le front de l’oint•e : l’huile des malades destinée au sacrement des malades, qu’on appelait autrefois « l’extrême onction » (qui dans la pratique de ce sacrement, n’est plus aussi extrême) ; l’huile des catéchumènes, utilisée lors des étapes de préparation au baptême ; le saint Chrême, huile consacrée, est utilisée pour le baptême, pour la confirmation et pour la consécration des ministres ordonnées, diacres, prêtres et évêques. Ces huiles, mélange d’huile d’olive et de baume [1] , sont le signe visible du don de l’Esprit que dispensent ces sacrements. Pendant la messe chrismale, ces huiles sont apportées dans le chœur par les diacres. Elles sont contenues dans de grandes jarres d’étain puis après la messe seront réparties en petits flacons entre toutes les paroisses du diocèse.
L'autel et la table
Les choses vraiment sérieuses commencent avec le second acte : c’est le Jeudi saint. Est commémoré ce jour-là le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C’est aussi l’entrée dans le « triduum pascal », ces trois jours qui ont changé le monde romain, et le monde tout court. Ce dernier repas, c’est la cène, dont les Italiens ont gardé le nom, « cena », pour désigner leur repas du soir, notre dîner (ou souper). C’est ce repas qui est rejoué, actualisé, à chaque messe en mémoire de Jésus – « vous ferez cela en mémoire de moi » - au cours duquel le pain et le vin sont changés en corps et sang du Christ. Christ est alors « l’agneau de Dieu », celui qui « enlève les péchés du monde ». L’agneau mâle est une référence à des rites sacrificiels du Premier testament : celui d’Abraham, mis à l’épreuve par Yahvé (Genèse 22) et celui des Hébreux, à la veille de leur sortie d’Égypte et de leur libération de l'esclavage, guidés par Moïse (Exode 12). Les paroles prononcées par Jésus et rapportées par les évangiles sont prononcées par le prêtre au cours de la consécration, moment-clé de la grande prière eucharistique par laquelle les chrétiens rendent grâce – c’est le sens du mot grec eucharistie - paroles performatives qui font ce qu'elles disent : « prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous » puis « prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». Les participants à la messe sont alors constitués comme « invité•es au repas de noces de l’Agneau », référence tirée du livre de l’Apocalypse selon saint Jean, où l’Agneau est une figure centrale.
Du partage au sacrifice
Des quatre évangiles, celui de Jean est le seul qui ne rapporte pas ce qui est devenu la consécration dans le rite chrétien de la messe. Il lui substitue une autre séquence, ce même Jeudi saint, au cours de laquelle Jésus lave les pieds de ses disciples, contre l’avis de Pierre qui s’insurge par trois fois de voir son maître s’abaisser ainsi devant lui et les onze autres. C’est pourquoi, au cours de la messe du Jeudi saint, le prêtre rejoue ce « lavement des pieds » avec une douzaine de paroissien•nes. En l’occurrence, c’est l’évêque d'Orléans, Jacques Blaquart qui a renouvelé ce geste, jeudi, dans l’église Saint-Paterne, lavant trois pieds droits sur douze (et laissant les autres à un diacre). Au total le Jeudi saint renvoie à deux valeurs, celle du sacrifice et celle du partage car dans le christianisme, l’autel du sacrifice est aussi, indissociablement, la table du repas.
Après son repas, Jésus entraîne ses disciples au jardin du mont des Oliviers pour prier. Mais ses disciples, inconscients de l’imminence du danger qui menace leur maître, ne parviennent pas à veiller avec lui, s’endorment et le laissent quasiment seul face à son destin qui va s’enchaîner dans la nuit et au matin du vendredi : arrestation, procès et jugement expéditifs, et, dans l’après-midi, crucifixion, à la veille du sabbat juif.
Une présence adorable
Aussi, après la messe qui commémore la cène et le lavement des pieds, une nuit d’adoration est proposée aux fidèles, dans l’église qui reste ouverte à cet effet. Est proposé à l’attention des fidèles le Saint-Sacrement un ciboire où repose cette présence cachée sous forme d'hosties consacrées. D'où le terme de « reposoir ».
Un chemin vers la mort
Le Vendredi saint, troisième acte de la semaine sainte, commémore la mort du Christ en croix. La cérémonie emblématique de ce jour est le « chemin de croix », un chemin qui est matérialisé dans toutes les églises, tout autour de la nef centrale, soit par une suite de croix numérotées, généralement en chiffres romains, de I à XIV (nombre fixé par le pape Clément XII au XVIIIème siècle), soit par des peintures ou des bas-reliefs représentant les étapes de ce chemin, depuis le jugement jusqu’à la mise au tombeau. Ce chemin de croix a souvent lieu à 15 h, l’heure estimée de la mort de Jésus : « vers la neuvième heure » telle que la rapportent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, au terme d’une agonie de trois heures qui débute à la « sixième heure ». Ce chemin peut être pratiqué à l’intérieur de l’église ou à l’extérieur, au cours d’une procession. L’origine de ce chemin de croix remonte aux célébrations du Vendredi saint instaurées au XIIIème siècle par les chrétiens de Jérusalem, et singulièrement les Franciscains, disciples de Saint François d’Assise, qui serait « l’inventeur » de ce rituel.
Concrètement, ce chemin de croix, qui ne fait pas l’objet d’un rite aussi fixé - hors la liste des stations [2] - que celui de la messe, se déroule ainsi : un célébrant, prêtre ou laïc, s’arrête devant chaque « station » - qui porte bien son nom - du chemin, énonce le titre de chaque action qui s’y déroule et l’explicite, récite une prière enrichie généralement d’un chant. Paul Claudel, parmi d’autres artistes, a rédigé un poème pour chaque station. Vendredi, à 15 h, dans l’église Notre-Dame des Miracles, les chrétien•nes présent•es ont refait ce chemin circulaire, à la suite de trois laïcs qui le conduisaient, longeant les murs de la nef, tandis que des prêtres alentour recevaient la confession des pénitents du jour. Car le Vendredi saint, soulignant que Jésus est mort à cause de nos péchés dont il est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection, est le moment propice pour demander pardon à Dieu, ce qui pour un catholique passe par la confession, sacrement délivré par le seul prêtre.
Le jour oublié
Le Samedi saint, en apparence, est un jour creux comme le creux du rocher évidé où, nous disent les évangiles, a été déposé Jésus, le creux qui épouse son cadavre enfermé à jamais d’une « lourde pierre » dans les ténèbres d’un tombeau et promis à retourner en poussière. Jour de tristesse, de non-événement, comme si rien ne se passait alors que peut-être, c’est là que tout a fermenté, qui a tout fait remonter et ressurgir. « Il sent déjà », disait Marthe à Jésus à propos de son frère Lazare mort et enterré depuis quatre jours et qui va sortir de la tombe à l’appel de son ami, tel un mort-vivant. Jour de déception que ce samedi. Après la tragédie, l'incompréhension, Oui, sans doute que ce samedi-là, tous sont déçus, amers que Celui pour lequel ils ont tout quitté les lâche au bord de la route, alors que, tout de même, s’il l’avait voulu, il aurait bien pu… Un Celui qui en perd temporairement sa majuscule. A-t-il entendu le « sauve-toi toi-même ! » des soldats romains qui gardaient le Golgotha, l’ultime invitation d’un monde qui s’était dérobé à lui, sur lequel il allait fermer les yeux, d’un grand cri ? Pourquoi s’est-il laissé faire comme un voleur, un bandit, un séditieux, lui qui a pourtant protesté au mont des Oliviers, quand on est venu l’arrêter : « Suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons ? » [3] Samedi saint, le monde est devenu incompréhensible, inexplicable, dénué de tout sens. C’est un présent qui semble avoir aboli tout ce qui a précédé au point d’obérer tout avenir.
Un samedi sans fin ?
Mais n’est-ce pas là que nous nous trouvons aujourd’hui, là où le cours du temps universel nous a stockés ? « Nous ne savons plus croire » écrit Camille Riquier. N’est-ce pas là pourtant que nous devrions nous tenir pour pouvoir reprendre une histoire qui serait authentique, en acceptant de vivre une vie qui ne serait pas perpétuellement « co-aperçue » (mitsehen) [4] dans la confortable interprétation de la mort que nous offre la résurrection du Christ et sa réplication en notre faveur, cette main tendue in extremis par Dieu au bord du néant ? Que célébrer en cet impossible samedi où a peut-être mûri le déni de la mort ? Comment pourrait-on le réintégrer dans ce triduum qui, comme les mousquetaires, sont quatre ? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche : si je compte bien, il y a quatre jours et non trois. Quelle manœuvre a aboli le samedi, l’a transformé en point aveugle, en jour saint oublié, quel est le sens de ce jour que l’on saute au point qu’il semble n’avoir jamais existé, si ce n’est pour une descente aux enfers, rattrapée de justesse par un des credo ? « Descendit ad inferos ». Est-ce que par hasard notre monde ne serait pas resté coincé dans un long samedi en enfer ? « Un jour je te décevrai et ce jour-là j’aurai besoin de toi » (Desnos). N'est-ce pas en ce long samedi où son Fils est tenu en échec que Dieu son Père a besoin de nous ?
Vers la lumière de Pâques
Puis vient la vigile, le samedi soir. Acte 4, qui débute à 21 h à la cathédrale Saint-Croix d’Orléans. Moment nocturne. Nous sommes plongés dans la nuit qui n’est plus celle ensommeillée et effrayée du jeudi au vendredi, réveillée par les voix du traitre et des soldats et agitée par le cliquetis des glaives. Non, c’est la nuit encore inquiète et muette, apeurée, dans l’attente d’un jour nouveau encore incertain. Nuit de genèse qui se rassérène peu à peu à la voix qui puise depuis le commencement dans les Écritures, dans le façonnement souterrain d’un nouveau commencement. Nuit interminable et impatiente de lectures, de psaumes chantés, de prières dites dans le froid de l’église. Nuit qui croise un feu auquel des cierges s’allument qui propagent leur flamme à d’autres et c’est tout un peuple qui entre dans le ventre de la cathédrale et va voyager jusqu’au bout de cette nuit la plus longue pour arriver au matin de Pâques. À ce feu s'allumera aussi chaque cierge pascal destiné à faire luire la résurrection du Christ dans chaque église, gravé de l'Alpha et de l'Oméga [5].
Le soleil victorieux
[1] En Orient, la composition des huiles est plus élaborée, avec adjonction de myrrhe, cinnamome, roseau aromatique, cannelle…
[2] Toutefois, en son temps, le pape Jean Paul II a modifié le contenu de certaines stations au motif que celui-ci ne pouvait pas s'appuyer sur un épisode relaté par les évangiles mais sur des traditions plus tardives.
[3] Lc 22,52
[4] Selon la remarque de Heidegger dans Sein und Zeit : « Die in der christlichen Theologie ausgearbeitete Anthropologie hat immer schon – von Paulus an bis zu Calvins meditatio futurae vitae – bei der Interpretation des « Lebens » den Tod mitgesehen. » (SZ, § 49 p. 249) (ce qui peut être traduit : « L'anthropologie élaborée dans la théologie chrétienne a toujours vu la mort à travers l'interprétation de la "vie" - de Paul à la meditatio futurae vitae de Calvin »)
[5] « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » (Apocalypse 22, 13)