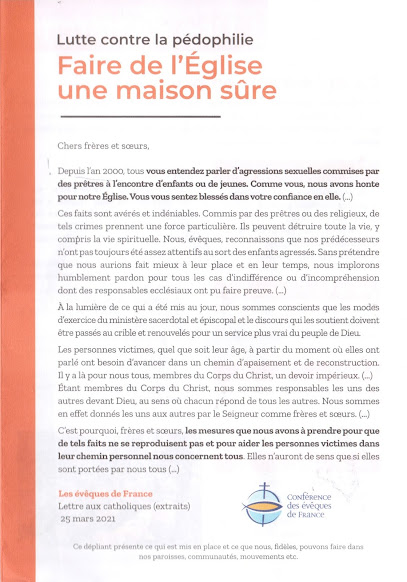Impressions d'un moyen-confiné presque déconfiné
Le temps retrouvé
Dans ce temps qui s’écoulait comme un flux continu, l’événement a fait irruption et lui a redonné brutalement ses couleurs : le passé, le présent et le futur se remettent à exister, il y a un avant et un après du pendant, une vision se débat entre mémoire et attente (Saint Augustin), fait en sorte que ni l’une ni l’autre ne puisse avoir raison d’elle. C’est maintenant que ça se passe, c’est maintenant que ça passe ou que ça casse. Mais ce maintenant dure et c’est cette durée, en tant que sensation existentielle, que nous éprouvons. Il y a quelques semaines, fait remarquer Étienne Klein, nous ne parlions plus que de la fin du monde, et voilà que nous parlons du "monde d'après". Comme si le mot "apocalypse" avait enfin retrouvé son vrai sens : révélation.
Darwin de retour
Il y a eu un court débat, national et international. Fallait-il laisser le virus courir au milieu du « troupeau » jusqu’à l’immunité collective au lieu de figer l’activité du monde et de confiner les humains ? C’était condamner d’emblée les plus faibles : les plus âgés, les diabétiques, les obèses, au profit de la vie économique maintenue. Car c’est une guerre à front renversé : ce sont les vieux qui meurent. Le choix du confinement n’a pas empêché que ce combat-là, celui des maisons de retraite et des Éhpad où nous avons logé nos anciens, soit d’ores et déjà perdu. Beaucoup de ces institutions se sont transformées en mouroirs accélérés, malgré toutes les précautions prises, sauf exceptions exemplaires comme ces personnels qui ont décidé de vivre en vase clos avec leurs pensionnaires.
La guerre
Puisque c’est la guerre, il nous faut un chef des armées. Selon la Constitution française, c’est au président de la République que sont dévolus ce titre et ce rôle. Au soir du 16 mars 2020, Emmanuel Macron déclare à cinq reprises « nous sommes en guerre ». L’anaphore se transforme en métaphore qui se diffuse dans son discours et dans toute la Nation. Il parle de « mobilisation générale », de « combat » contre l’épidémie et envoie les soignants « en première ligne ». En choisissant le vocabulaire de la guerre, le président s’est placé une nouvelle fois au sommet de la pyramide de commandement, responsable et le cas échéant coupable de tout ce qui va advenir. Sauf que dans la Ve République, ce n’est pas lui le fusible.
Les indispensables et… les autres
Alors que tout le monde se «confine », il faut qu’un ministre de l’Économie rappelle le jour d'après, d’un air un peu inquiet, qu’il y a des gens « indispensables » et que ceux-là, on attend qu’ils fassent leur travail comme d’habitude, pour nous soigner, nous nourrir, nous transporter, nous informer, nous enterrer. S’il y a un front de la Santé, il faut aussi assurer l’arrière, avec l’armée des boulangers, des agriculteurs, des caissières de grandes surfaces, des chauffeurs de poids lourds et des conducteurs de trains ou de bus, des journalistes et des factrices, des policiers et des croque-morts, etc… Il y a donc a contrario toute une partie de la population – et j’en suis - qui n’est pas indispensable, la preuve : le monde continue à tourner sans elle. Cruel constat. Je suis inutile. À la retraite depuis neuf ans, je commençais à m’en douter. Mais celle qui est à mes côtés commence le 19 mars un roman utile avec son frère qui est au loin, confiné lui aussi, mais d'une façon plus rude.
Vers une « carte de temps » ?
Il nous revient alors une nouvelle de Marcel Aymé dans Le passe-muraille, La carte, inspirée de l’époque des rationnements des années de guerre. Le bruit court d’abord qu’il « serait procédé à la mise à mort des consommateurs improductifs : vieillards, retraités, rentiers, chômeurs et autres bouches inutiles. » Mais ce n’est heureusement qu’une rumeur comme il y en a tant dans ces périodes de disette. Finalement, il est décidé qu’ « on rognera simplement sur leur temps de vie. […] ils auraient droit à tant de jours d’existence par mois, selon leur degré d’inutilité. » Des cartes de temps sont déjà imprimées et le narrateur, qui est écrivain, s’indigne que sa catégorie ait été classée parmi les inutiles qui n’auront droit qu’à quelques journées de vie par mois. La vie confinée ne ressemble-t-elle pas à cette vie, rognée inégalement, décrite par Marcel Aymé ?
L’effort de guerre
L’arrière est mobilisé. Pour leurs récoltes saisonnières, fraises, haricots verts, asperges, etc. les paysans français recourent d’habitude à des bras maghrébins qui, présentement, sont cloués au sol dans leurs pays respectifs. Un appel est lancé. Il faut trouver 100 000 personnes. Je regarde un reportage où une puéricultrice, l’arme au pied depuis que les crèches sont fermées, s’est proposée courageusement de participer à la cueillette. Au lieu de se pencher vers des marmots, elle va se courber sur des rangs de petits pois. Le maraîcher commente : « pour le moment, elle fait du 2 kg à l’heure. Je perds de l’argent. Un saisonnier fait du 4 à 5 kg de l’heure ». L’histoire ne dit pas si la productivité de la puéricultrice s’est améliorée ou si l’exploitant a renoncé à sa récolte.
Tous phénoménologues !
La crise pandémique accomplit le rêve de tout phénoménologue : assister à la suspension du monde, à sa mise entre parenthèses, à « l’épochè ». Du fait du confinement des êtres humains, le monde, en effet, s’efface peu à peu, la croyance spontanée dans son caractère objectif s’affaiblit, ouvrant la voie à un mouvement général de « retour aux choses mêmes », celui-là même que préconisait Husserl pour réapprendre à penser notre rapport au monde, défaits de nos préjugés. S’il n’y a plus de monde, comment peut-il encore y avoir des objets ? Parce qu’il y a un horizon et que c’est sur ce fond d’horizon qu’ils continuent à se détacher. Merci à Adèle Van Reeth qui, même confinée, continue à nous emmener sur Les chemins de la philosophie.
La nature reprend ses droits
Les animaux, la nature tout entière semblent s’engouffrer dans cette suspension. On assiste à des spectacles étonnants. Un chevreuil gambade sur une plage et se jette dans l’Océan pour y nager longuement : en voyant cette image, on a envie de lui crier comme une mère à son enfant « reviens, ne va pas trop loin ». Mais le chevreuil n’écoute pas et il ne se noie même pas. À Paris, des canards se dandinent sérieusement devant la Comédie française et le Conseil d’État. À Orléans, en pleine ville, un chevreuil encore se promène au petit matin sur une des artères la plus fréquentée en temps normal. La Seine redevient limpide, on en voit le fond et çà et là un Vélib’ d’avant échoué sur le lit du fleuve. En Inde, pour la première fois depuis 30 ans, l’Himalaya est visible à plus de 250 km.
I just called to say I love you
C’est le moment de se dire « je t’aime » dans l’impuissance où l’on est, devant cette loterie à la vie à la mort, cette roulette russe chinoise, rouge ou noir, pair ou impair, quel pouce décide de notre sort dans ce cirque, la balle qui m’est destinée est-elle déjà dans le barillet ? Et pourtant, je continue à me croire immortel, en SEXagénaire. Le téléphone reprend du service, 'I just called to say I love you ♫' comme le chantait Stevie Wonder en… 1984. On se skype, on se textote, on se courrielle et l’on conclut le plus souvent par la formule à succès du moment : « prends soin de toi ».
Police de la santé
Radio et télévision diffusent de façon lancinante les conseils de prévention qui inscrivent jusque dans notre cerveau reptilien les « gestes barrière », qui auraient pu être dits « protecteurs », imposant la « distanciation sociale », au lieu de « physique », comme si les inégalités existantes ne suffisaient plus, proscrivant les « embrassades », mais n’allant pas jusqu’à interdire les rapports sexuels. Il nous faut désormais remplir une « attestation de déplacement dérogatoire », dûment cochée, pour aller faire ses courses ou faire une courte promenade « dans un rayon d’1 km ». Nous la gommons tous les jours. Une application se propose très vite sur Internet pour reporter ce rayon sur une carte… Et bientôt l’attestation est sur nos téléphones portables. Plus tard, ce sera la course aux masques et les oreilles douloureusement décollées par leurs élastiques.
Addition de drames ou simple statistique ?
A cela s’ajoutent les conférences journalières du ministre de la Santé et de son directeur, les duettistes Véran et Salomon, qui égrènent le décompte macabre des décès, des cas déclarés, des admissions en réanimation, etc. Un adage bien connu des statisticiens l’énonce : 1 mort, c’est un drame, 100 morts une catastrophe, 1 million de morts, une statistique. Avec 2000 morts journaliers, on est un peu au-dessus de la moyenne puisqu’il y en a bon an mal an 600 000 en France. Le seul chiffre intéressant serait celui de la surmortalité. Mais il n’est connu qu’après coup, dans un délai qui n’est pas compatible avec celui du spectacle qui impose sa loi aux politiques, coincés dans l’immédiateté, entre les médias et l’opinion, et condamnés à faire leur la maxime célèbre de Cocteau : « puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs ». On n’a pas de masques ? Disons que les masques ne sont pas nécessaires. Etc. Ah, oui : il nous resterait à applaudir les soignants : mais à la campagne, personne n'est à sa fenêtre à 20 h. À la place, l'Angelus continue à sonner trois fois par jour et les oiseaux à chanter jusqu'au coucher du soleil.
Enterrer les morts
Les obsèques pouvaient faire croire qu’on ne mourait pas seul. Or il n’y a plus d’obsèques, les vivants et les morts sont débarrassés des formules du souvenir et de l’espérance : ni biographie esquissée ni paradis entrevu. Laïc engagé depuis peu dans la célébration catholique des obsèques dans ma commune rurale, c’est dans un cimetière, à ciel et tombe ouverts, et non dans une église, que je vais animer ma dernière cérémonie d’enterrement, le 16 mars. Je le fais malgré l’opposition de ma femme qui m’avait fait me décommander, dans un premier temps, pour laisser officier un prêtre à ma place. Je m’étais senti lâche et j’avais décidé d’assumer la cérémonie à son insu. Les obsèques suivantes dans le secteur vont être prises en charge par les prêtres disponibles, mais réalisées la plupart du temps dans « la plus stricte intimité familiale ». Cette formule qui pointait naguère une volonté positive des familles ou du défunt n’exprime plus qu’une contrainte négative : on enterre les morts à la sauvette. On meurt à la sauvette aussi. Un de nos amis décède brusquement à Paris dans la maison de retraite où il avait été admis quelques semaines auparavant, dans la nuit du 28 au 29 mars, sans qu’on sache de quoi précisément – il avait eu « des problèmes respiratoires » deux jours avant - et nous ne pouvons pas l'accompagner ni les siens. Cette histoire, qui cette fois nous concerne, est pourtant tristement banale, répétée par milliers chaque jour de par le monde
La religion à l’arrêt ?
Le dimanche 1er mars, premier dimanche de Carême, Mgr Blaquart, l’évêque d’Orléans, fait passer des consignes, que je commente ainsi à un ami : « Mgr Blaquart a fait lire en chaire les consignes prophylactiques suivantes : plus de baiser de paix, plus de communion sur la langue, plus de ciboire où l'on boit à tour de rôle (intinction obligatoire), plus de serrage de louches par le prêtre à la sortie de l'église. On annonce encore des pèlerinages à Paray-le-Monial et Lourdes, mais je doute que ça tienne longtemps. Cher prophète, pouvons-nous encore embrasser nos femmes ? ». Le 14 mars, les cérémonies religieuses non indispensables sont suspendues par le gouvernement. Et les obsèques sont strictement encadrées (moins de 20 personnes, y participer entre dans le cas des déplacements autorisés pour « motif familial impérieux). Ceci va durer jusqu’au samedi 24 mai, un arrêt du Conseil d’Etat autorisant le reprise des cultes. Entre temps, de nombreux prêtres auront découvert YouTube, célèbreront des messes devant les photos de leurs paroissien•nes, diffusées via Internet, obtenant parfois des audiences supérieures à celles qu’ils auraient eues dans leurs églises ouvertes. Les catholiques sont ceux qui vont-à-la messe : privé de culte dominical, est-on encore un « tala » ? Les chrétiens auront eu l’occasion de pratiquer Matthieu 6, 6 : « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. » Et aussi Matthieu 25 : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi! » Quand donc Seigneur avons-nous fait tout cela ? interrogeront les justes, étonnés, au jour du jugement. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Enfin les prêtres eux-mêmes pourront relire la « messe sur le monde » de Teilhard de Chardin. « Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l’Aisne, mais dans les steppes d’Asie, je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde. » Voilà une belle prière à transposer pour un prêtre par temps de confinement. « Puisque pour la première fois, Seigneur, je n’ai ni église, ni autel, ni fidèles, etc. »
Du temps perdu ?
Marie-Aude me signale une interview de Christophe Honoré dans Le Monde du 1er mai au titre en apparence bien plombant : « Ce temps imposé est un temps empoisonné ». Le point de vue de l’artiste fournit pourtant un contrepoint utile à tout un tas de commentaires entendus depuis des semaines, parfois cuculs ou lénifiants. Je commente le propos d’Honoré sur Facebook :
"À rebours de tous ceux et toutes celles qui s’efforcent de lire le sens du moment que nous vivons, ensemble et pourtant isolé•es, et d’en donner une interprétation, Christophe Honoré veut ne rien voir de positif dans le temps du confinement. Le titre de l'article est chargé d’une belle allitération : l'imposé serait nécessairement un poison. Pour l'artiste, ce temps est perdu, corps et biens. Logiquement, il nous dit qu’au lieu de nous évertuer à lui trouver un sens, nous ferions mieux d’admettre cette perte, « pour laisser la possibilité qu’il y ait un temps retrouvé ». Belle conclusion mais dont l'esthétique gauchit sans doute le propos proustien. Ce n’est pas un temps perdu que l’on retrouve dans la Recherche, comme un objet oublié ou égaré, c’est un temps traversé. Non pas ce temps ordinaire, dont la fluidité nous le fait oublier pour nous conduire plus vite à la mort, mais un temps opaque, difficile, « visqueux » dirait un Sartre, à travers lequel il faut se frayer un chemin. Un temps d’épreuve, notion inaperçue d’Honoré, même s’il l’entrevoit en évoquant « le passage du temps » et « les traces laissées par l’événement ». Il reproche surtout, à juste titre, qu’on réduise l’événement pur de la maladie qui nous assaille au châtiment du consommateur de la société ultralibérale. Mais en « ratant » la notion d’épreuve, il réfute ipso facto, implicitement, celle d’apprentissage - la Recherche est pourtant un, sinon LE, roman d'apprentissage, de l’auteur et de Swann en même temps - dans une posture assez nihiliste, ne voyant que la destruction en nous, refusant aussi bien de « s’adapter à la situation » que de s’évertuer à « donner un sens à ce qui se passe ». Ce qu’il est conduit tout de même à faire le temps d'une interview. Sans doute parce qu'il ne peut pas fermer la discussion comme il tente de le faire en affirmant que c’est « un événement historique, point ». C’est justement parce que l’histoire n’a pas encore mis ce « point » qu’elle reste fondamentalement ouverte. D'ailleurs, y a-t-il des événements purs – du style ‘un Chinois mange un pangolin infecté par une chauve-souris’ ? Tout événement du fait même qu'il (nous) arrive est toujours-déjà historique, et c’est cette arrivée transcendante, qui est l'essence de l'historicité, qui interdit le « point » en nouant d'emblée la discussion : des causes, des effets, du sens pour les humains et pour la Nature, à reporter à l'infini dans l’Histoire et son (dis)cours."
Et si c’était un rite de passage ?
Cette fois-ci, c’est ma fille qui me signale un article du site The Conversation qui reprend les analyses d’un anthropologue, Arnold Van Gennep sur les rites de passage. Celui-ci distingue trois étapes, séparation, liminarité et incorporation. Reprenant ces stades, l’autrice et l’auteur de l’article suggèrent d’assimiler notre confinement à la liminarité, ce seuil inconfortable qu’il faut franchir pour passer d’un état stable à un autre, de l’enfance à l’âge adulte par exemple au prix le plus souvent d’épreuves initiatiques difficiles mais toujours assurées de leur résolution par la communauté qui les organise. Ici, point d’instance bienveillante qui surveillerait la bonne fin de notre initiation. Mais l’épreuve étant là, comment ne pas réfléchir aux conditions à créer pour l’accueillir au mieux et la traverser ? L’article de Vanessa Oltra et Gregory Michel, deux Bordelais, est très suggestif.
Le ressort et le cliquet
Cette crise a nourri aussi une conviction ou un espoir que le « monde d’après » ne serait pas le même que « le monde d’avant ». Il me semble qu’à cette idée utopique ou romantique, voire métaphysique, des choses, on devrait substituer une vision plus pragmatique de la réalité capable de distinguer deux mouvements distincts. Je retiens deux images, plutôt mécaniques, celles du ressort et celle du cliquet.
Le ressort, m'indique Wikipedia, c’est un organe ou une pièce mécanique qui utilise les propriétés élastiques de certains matériaux pour absorber de l'énergie mécanique, produire un mouvement, ou exercer un effort ou un couple. Il accepte de s’écraser, mais dès que les forces qui s’appliquaient à lui renoncent, il se détend et revient à sa position initiale ou peu s’en faut. Le ressort amortit les chocs les plus brutaux au risque d’allonger leurs effets dans le temps. Qu’on pense à une 2 CV passant sur un cassis et on aura une bonne image des vertus et des inconvénients de l’amortissement.

Pour le même Wikipedia, le cliquet, lui, est un mécanisme qui maintient un système en l'état ou — plus généralement — l'empêche de revenir en arrière et le force à aller de l'avant. S’il y a un « sens de l’Histoire », c’est à un effet de cliquet qu’on le doit, même si l’Histoire, qui n’est pas une mécanique, échappe évidemment en partie au cliquet, ce qui nous vaut quelques retours en arrière. Le cliquet garantit que l’effort que vous déployez pour mouvoir quelque chose ne va pas être anéanti en totalité par une défaillance ou une distraction de votre part. Il permet aussi que cet effort soit interrompu sans en perdre les premiers résultats. Quiconque a déjà manœuvré certain type de cric ou les vannes d’une écluse sait à quoi sert un cliquet.

On peut parier qu’une partie des choses comprimées pendant cette période – le confinement aura été une forme de compression - va nécessairement se détendre, reprendre sa place et son volume antérieurs, après quelques oscillations qu’on lira aussi comme des hésitations, des regrets ou des remords. Et après tout, ce n'est pas un ressort qui va nous dicter notre vie.
Une autre partie des choses – j’emploie volontairement ce terme vague, générique – se refusera à revenir en arrière. Nevermore. C’est l’effet du cliquet, bénéfique et angoissant qui nous jette en avant, contraints en quelque sorte par nos acquis, de nouvelles habitudes prises, dont certaines vertueuses. Ce seront alors aussi des refus, des revendications. La naissance d’un autre monde possible. Alors l'épreuve n'aura pas été inutile, individuellement et collectivement. Alors nous le devrons, cet autre monde, à celles et ceux qui n'en seront pas revenu·es, à celles et ceux qui nous aurons sauvé·es.