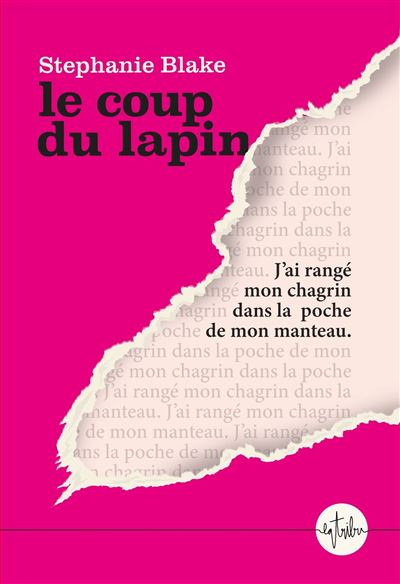En 1984-85, notre fils Benjamin, né en 1977, allait sur ses 8 ans. Il était en CE1 à l'école primaire de la rue Neuve-Saint-Pierre, dans le IVe arrondissement de Paris. Son maître d'école, M. Lemoine eut la bonne idée de demander à tous les élèves de faire raconter par leurs parents et leurs grands-parents "comment c'était la vie et l'école" quand ils avaient leur âge. Ma mère, Micheline, écrivit un texte, Marie-Aude et moi, aussi.
***
Témoignage de Micheline Robert, née Foulonneau (grand-mère paternelle de Benjamin, née en 1920)
Cher petit Benjamin
Je réponds à ton enquête pour moi-même et ton grand-père Jacques.
Tu sais qu'à neuf mois près, nous sommes du même âge tous les deux ; en 1927, 1928, nous avions sensiblement ton âge. Nous sommes nés en Poitou-Charentes, ton grand-père à COURCOURY, petite commune campagnarde que tu connais et aimes bien et dont le nombre d'habitants est resté pratiquement inchangé, et moi, ta grand-mère, aux MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE dans les Deux-Sèvres, autre petite commune similaire, à la limite de la Vendée et aux coutumes différentes. Nous parlions un français déformé par le patois environnant.
La maison où je suis née était indépendante, au centre du ''bourg'', face à la place et à l'église. J'y étais bien. Mais, lorsque j'eus sept ou huit ans, mes parents déménagèrent pour s'installer dans une petite, très petite ville distante de dix kilomètres : L'ABSIE. Là, toutes mes habitudes changèrent et cet événement me marqua beaucoup car j'entrai dans une nouvelle école où je ne connaissais personne. J'avais quitté mes maîtresses, mes amis que je ne revis plus car les moyens de communications étaient inexistants : des voitures à cheval, peu d'autos (mes parents n'en possédaient pas). Pour rejoindre un train il fallait parcourir plusieurs kilomètres à pied ou à bicyclette.
Aussi, à cette époque, je fus éblouie par une sortie exceptionnelle avec des parents de ma mère, venus nous rendre visite avec leur taxi parisien. J'admirai beaucoup cette grande auto noire à marchepied, avec vitre intérieure séparant le conducteur des passagers et j'appréciai le confort des sièges en cuir noir également.
Dans ma nouvelle maison, nous nous éclairions toujours à la lampe à pétrole, avec une suspension pour les pièces principales et des petites lampes ''Pigeon'' pour les déplacements d'une pièce à l'autre. Pas de téléphone, de télévision ni de radio; un journal hebdomadaire lu et commenté par mon père. Pas de baignoire : pour les soins quotidiens, nous avions une ''fontaine'' à réservoir d'eau, avec robinet et cuvette en-dessous, le tout sur un socle accroché au mur. Pour le corps, une grande bassine dans laquelle nous mettions l'eau chauffée dans la « bouillotte » d'une cuisinière à bois.
Sur cette cuisinière se faisaient chauffer les repas et dans le four, les rôtis et les gâteaux. Je mangeais à peu près comme toi maintenant. Sans doute moins de viande, des légumes du jardin, des fruits du pays et des fruits secs, du chocolat, des confitures, parfois au goûter de grandes tartines de riz au lait, très sucré et chaud l'hiver. Pas de fruits exotiques, des oranges seulement pour Noël.
Les soirs d'hiver, nous allumions la cheminée et je commençais à cette époque à faire la lecture à haute voix pour mes parents qui bricolaient pendant ce temps. Je me souviens avoir lu La porteuse de pains au cours de ces veillées. J'aimais ce moment avec les miens.
Je dus apprendre à lire assez facilement avec un livre unique, commençant par les voyelles, et les consonnes isolées, puis l'assemblage des unes et des autres. Quelques dessins en noir et blanc illustraient ce livre. Ensuite, chaque élève avait ses livres personnels, fournis par l'école et achetés par les parents. J'écrivais à l'encre violette, avec un porte-plume, et j'avais une ardoise.
Il n'y avait pas de piscine. Je ne suis allée en vacances que quelques jours chez des cousins. Avec la classe, nous sortions entre amies, le dimanche, après les vêpres pour une promenade dans les bois. Nous jouions aussi aux jeux de société, ou au croquet, dans la cour. Nous avions une bibliothèque gratuite. Nous préparions aussi des petites séances de théâtre, pour une fête de Noël, avec des chants, des danses, des saynètes. Pour la fin d'année scolaire, nous participions à une grande représentation de théâtre en plein air, avec distribution des prix, sur une scène où rien ne manquait : estrade, décors, coulisses, rideaux, souffleur etc.. Quand les trois coups étaient frappés, mon cœur battait très fort. Etaient présents pour nous applaudir : nos parents, nos amis, nos camarades et, au premier rang, des personnalités bienfaitrices qui nous remettaient solennellement, ensuite, et par ordre de mérite, de jolis livres rouges, reliés et dorés sur tranche, plus ou moins gros et nombreux selon notre réussite scolaire
La vie de ton grand-père Jacques était un peu plus rurale. Il aimait parcourir les champs avec son chien, au sortir de l'école et s'ébattre librement. D’où son goût très fort de la nature, et sa passion actuelle pour la chasse et pour la pêche. Lui comme moi, à sept-huit ans, n'avait pas vécu la guerre, mais il en entendait beaucoup parler dans sa famille, par ses parents, ses oncles. Nous avons vécu plus tard celle de 1939-40, très différente. A huit ans, nous avions moins de jouets que toi. Moi, mes poupées, berceaux et autres, des jeux de l’oie et de loto partagés avec des copains et des copines, rien de mécanique. Jacques avait son autoskiff, sa trottinette, son fusil à flèches ; c'était très beau pour l'époque. J'enviais beaucoup les tricycles que j'admirais de longues heures dans un magasin près de chez moi, où il y avait de tout. Je rêvais avec le catalogue de La Samaritaine et découpais les petits bonshommes pour monter une école en papier : chacun avait son nom écrit derrière. J'avais aussi un chat, ''Pompon'', dont je faisais ma poupée lorsqu'il voulait bien, couché sur le dos, les pattes en l'air sous les couvertures... quelques minutes.
A l'école, les garçons et les filles portaient une blouse en satinette noire, plissée sur le devant ; la ceinture était nouée dans le dos ou, pour les garçons, la blouse boutonnée sur le côté. L'hiver, nous portions un manteau ou pèlerine à capuchon pour la pluie, un béret. des mi-bas et guêtres en laine ; aux pieds, des galoches de cuir à semelles de bois, montantes pour les garçons. L'été, des sandales en cuir, genre « Knickers » actuels. Le dimanche nous avions des tenues de fête plus élégantes, et toujours un chapeau de feutre ou de paille, selon la saison, et une casquette pour les garçons. Nous n’avions pas d'argent à cette époque, sauf quelques pièces : le ''sou'' et le ''2 sous'', pièces en bronze pour acheter quelques bonbons ; il y avait aussi les pièces en nickel percées de 5 centimes, 10 et 25, puis des pièces jaunes à partir de 50 centimes; ensuite, des billets que personne ne nous confiait.
Je pourrais t'écrire beaucoup d'autres souvenirs de cette époque, mon petit-fils chéri, mais ce serait bien long. La possession de l'automobile commençait juste à se vulgariser. Nous sortions pour voir les ''dirigeables'' dans les airs, et les premiers avions étaient rares dans nos ciels de campagne.
***
Témoignage de Pierre-Michel Robert (père de Benjamin, né en 1950)
A
l'âge de sept ans, je vivais en Côte d'Or : c'est une marque de
chocolat mais c'est aussi le nom d'un département de l'est de la
France. La capitale en est DIJON et moi, j'habitais à vingt-cinq
kilomètres au nord, dans une ville de deux mille cinq cents
habitants environ.
Mon
père, fonctionnaire, avait été nommé là, loin de sa Charente-Maritime natale ; il avait accepté ce poste pour avoir un travail plus
intéressant et mieux rémunéré.
La
ville s'appelait IS-sur-TILLE, car elle était construite au bord
d'une petite rivière, la Tille.
Auparavant
nous habitions à PARTHENAY, c'est là que j'étais né, au milieu du
XXème siècle, et que j'avais passé les quatre premières années
de mon existence. J'ai un souvenir très précis du long voyage que
nous avions dû faire, lors de notre déménagement. Nous avions
traversé la France, d'ouest en est. C'est ma mère qui conduisait la
''quatre-chevaux'' (4 CV) dans laquelle j'avais pris place avec ma
soeur et mon frère. Mon père était déjà parti et nous attendait.
Après un trajet sans histoires, alors que nous étions presque
arrivés, la voiture se mit soudain à glisser dans un virage et nous
nous retrouvâmes dans un champ.
Heureusement,
il y avait plus de peur que de mal : le verglas très fréquent sur
les routes du Morvan, nous avait joué un tour à sa façon.
La
maison d'lS-sur-TILLE ne nous appartenait pas. Nous étions les
locataires de gens qui nous paraissaient très riches : le mari était
vétérinaire et je me souviens de la grande maison de nos
propriétaires, recouverte de vigne vierge ; on y entrait par un
perron sur lequel veillaient jalousement quatre ou cinq petits chiens
blancs, des Loulous de Poméranie, toujours en train de japper sur
l'allée de graviers qui bordait la façade.
Les
hivers sont rudes en Côte d'Or. Notre maison était chauffée par
des poêles à charbon qu'il fallait garnir et parfois rallumer le
matin, après les avoir nettoyés : il fallait retirer la cendre,
remettre du papier journal et du petit bois puis, une fois que le
poêle ronflait, ajouter le charbon. Il y avait dans la cave un grand
tas de boulets noirs et luisants que mon père désignait parfois
d'un nom mystérieux pour moi : ''anthracite''.
Dans
la salle à manger, où nous ne prenions nos repas que le dimanche,
trônait un immense piano à queue noir sur lequel s'exerçaient ma
sœur et mon frère. Je devais m'y mettre un jour, moi aussi, sous la férule de Mademoiselle Girodet, qui jouait aussi de l'orgue à l'église. Et, sur
le piano, était posé le poste de radio, un gros appareil à lampe
qui avait besoin de chauffer avant d'être en état de fonctionner.
Tous
les dimanches, nous écoutions la ''T.S.F.'' comme on disait encore à
l'époque, et notamment les matchs de football retransmis en direct
et commentés par des journalistes qui nous faisaient partager toutes
les émotions du stade. Des noms de joueurs célèbres sont ainsi
restés gravés dans ma mémoire : Just Fontaine, Kopa,
Piantoni.
Il
y avait aussi une certaine Geneviève Tabouis qui faisait une
causerie hebdomadaire sur les événements politiques : mon père
l'écoutait avec attention, comme s'il s'était agi d'un sermon de
Carême.
Car
le dimanche, c'était surtout le jour où nous allions à la messe ;
mes parents étaient catholiques, et nous élevaient dans le respect
des traditions religieuses. Le curé de la paroisse était un homme
très ingénieux ; comme tous les prêtres à cette époque, il
prononçait ses sermons du haut de la ''chaire'', une sorte de petite
tribune individuelle surélevée qui flanquait un des piliers de
l'église. Ayant remarqué que cette chaire, dans toutes les églises,
gênaient la vue de certains fidèles, il s'était fait construire
une sorte de chaire métallique sur roulettes qu'un dispositif
permettait de faire pivoter autour du pilier et d'effacer ainsi de la
nef, pendant la messe, une fois son sermon terminé.
Dans
notre maison, il y avait l'électricité mais pas le gaz. Toute la
cuisine était faite à l'aide d'une cuisinière à charbon qui
comportait un réservoir d'eau chaude que l'on utilisait le soir pour
préparer des bouillottes que nous mettions au pied du lit afin de
nous réchauffer.
L'argent
dont nous nous servions ressemblait à celui d'aujourd'hui mais, ce
que nous appelons maintenant des centimes'' était alors des
''francs''.
J'avais
des jouets. Ceux que m'avait laissés mon frère aîné et notamment
son ''Meccano'', jeu de construction tout en fer, avec des vis et des
écrous, et de vrais engrenages qui pouvaient être animés par un
petit moteur électrique.
Je
me souviens aussi d'un train électrique, beaucoup plus gros que ceux
que l'on voit maintenant, et lui aussi tout en métal. De temps en
temps, le plus souvent à l'occasion d'un déplacement à DIJON, la
grande ville toute proche, je me faisais offrir une voiture miniature
en métal : c'était toujours une ''Dinky toy'', la marque la plus
célèbre à l'époque. J'avais peu de jouets en plastique: ni le
''légo'' ni les ''playmobil'' n'existaient, mais il y avait déjà
des petits soldats.
C'est
drôle, mais je ne me souviens pas de la façon dont j'ai appris à
lire ; les livres, en 1957-58, n'étaient pas très différents
de ce qu'ils sont maintenant. Simplement, il n'y avait presque jamais
de photographies et, quand il y en avait, elles étaient en noir et
blanc.
Il n'y avait pas de sorties de classe : je ne suis sorti avec
des copains qu'à partir du moment où mes parents m'ont inscrit aux
''louveteaux'' et où nous faisions des randonnées dans la campagne
toute proche, apprenant à lire des cartes et à nous orienter à
l'aide d'une boussole.
A
l'école, j'ai appris à écrire avec un porte-plume : au bout
d'un petit manche en bois, de la taille d'un crayon, était fixée
une plume d'acier ; sur notre bureau, il y avait un trou dans lequel
se trouvait un encrier. Nous écrivions en trempant régulièrement
la plume dans l'encrier et nous avions souvent les doigts tachés.
Nous étions aussi obligés d'utiliser du buvard, sorte de papier
absorbant avec lequel nous séchions les pages de nos cahiers avant
de les refermer.
***
Témoignage
de Marie-Aude Murail (mère de Benjamin, née en 1954)
J'avais
sept ans en 1961. Je suis née au Havre, une ville de Normandie, qui a
été en grande partie détruite en 1944 sous les bombardements de la seconde
guerre mondiale. J'habitais donc un quartier rénové, d'aspect un
peu triste, sur le Boulevard maritime qui menait au port et où le
vent soufflait souvent fort. Nous vivions en appartement. Je me
souviens surtout du couloir où nous jouions au football, mon frère
et moi.
Nous
n'avions pas la télévision mais, bien sûr, nous avions tout le
confort moderne d'alors. Je ne te dirai rien au sujet de la
baignoire. Je ne crois pas qu'à l'époque la salle de bains
m'intéressait beaucoup.
Nous
avions une grande voiture car nous étions sept personnes dans notre
famille, quatre enfants, les parents et ma grand-mère. Nous allions
en vacances et même en week-end car nous avions une belle chaumière
à Foucart, une vraie de vraie chaumière, avec le toit de chaume,
les murs blanchis à la chaux et des chèvres qui crottaient un peu
partout .
Je
ne suis jamais allée en colonie de vacances mais l'année de mes
sept-huit ans a été marquée par un événement important pour la
petite personne que j'étais. Mes parents ont déménagé pour
« monter » à Paris. Comme ils ne souhaitaient pas avoir
tous ces enfants dans leurs pattes pendant le déménagement. nous
sommes allés avec ma grand-mère dans une maison de repos où il
fallait faire la sieste ! Tu penses si j 'en avais besoin à huit ans
alors qu'il y avait des bois tout alentour...
A
sept ans. je savais déjà bien lire et j'étais en CE2. Je suis
allée au lycée à cinq ans chez madame Philippe. Quand on faisait
une bêtise, on allait au coin. Cela me paraissait une punition
terrible. J'y suis allée une fois parce que j'avais oublié ma boîte
de peinture. Dans la classe et dans l'école, il n'y avait presque
que des garçons. Moi, on m'avait acceptée au lycée du Havre parce
que mes deux frères y allaient déjà. On jouait aux
autos-tamponneuses, aux billes, et à la guerre. J'avais très peur
d'être sur la liste de guerre des garçons. Ça voulait dire qu'à
la récréation, ils vous tombaient dessus. Quand je suis arrivée à
Paris, je ne connaissais pas du tout les jeux des petites filles et
j'ai dû apprendre la marelle, les comptines, les rondes, la corde à
sauter.
A
la maison, je jouais aussi. avec les jouets de mes frères, les
soldats et les petites voitures. J'avais des poupées mais j'ai
toujours préféré les animaux en peluche. J'avais aussi une petite
épicerie pour faire la marchande et une école avec des poupées
derrière leurs bureaux. Ça me plaisait bien de faire la maîtresse
et de les mettre au coin. Mais je me demande si mon meilleur jouet,
ce n'était pas ma petite sœur. La pauvre! Je voulais lui apprendre
à lire : ''Toto a vu la lune. Lili a ri.'' J'avais un mal fou. Des
fois, j'en criais de colère et ma petite sœur allait se plaindre à
maman.
Mais
mon grand malheur, c'étaient mes vêtements. J'avais des tricots en
mohair, et ça gratte, le mohair. J'avais des
passe-montagne pour l'hiver et on vous tire dessus, à l'école.
J'avais des grosses chaussettes rouges en laine et ça pique, la
laine. Puis, le dimanche, on mettait des faux-cols blancs sous la
robe écossaise et des gants blancs, pour faire vraiment chic. A
l'école, à Paris, il était interdit aux petites filles de mettre
des pantalons même s'il faisait très froid. La directrice ne
voulait pas.
La
nourriture n'était pas très différente de ce que tu connais. Je
crois qu'on mangeait plus de soupe et de légumes frais. Le dimanche,
on achetait des gâteaux à la boulangerie. C'était vraiment un
grand moment dans ma semaine. D'ailleurs, je voulais être boulangère
plus tard pour manger de tous les gâteaux, parce que rien qu'un, ce
n'est pas assez.
***