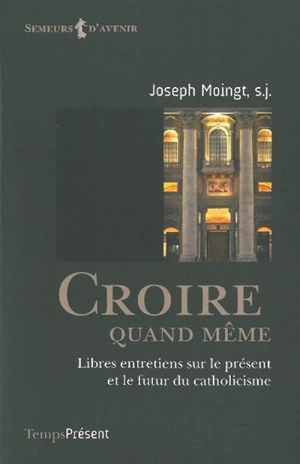L'évangile selon Carrère
« Je ne sais pas ». C’est par ce doute ultime qu’Emmanuel Carrère conclut 630 pages de dialogue avec le chrétien à durée déterminée qu’il a été, pendant ce qu’il nomme aujourd’hui une « crise ». Cette crise forme le premier chapitre de son livre, le plus personnel. Il s’agit d’une crise de foi, mais non à la manière d’un croyant frappé par le doute : plutôt à celle d’un agnostique - qu’il est redevenu après cette parenthèse de trois années de foi intense - brutalement enjoint de croire avec ferveur, après une enfance chrétienne de convention et sans éclat mystique, une enfance « christianiste » dirait Rémi Brague. Une marraine croyante, très aimée, l’accompagne dans cette « crise », comme l’accompagnera aussi Hervé, cet ami plein de sagesse auquel Le Royaume doit également beaucoup.
Ce dialogue avec sa propre histoire, avec cette « crise » consignée dans « dix-huit cahiers à reliure cartonnée » qu’il va redécouvrir et relire, Carrère le commente et il l’a nourri, à l’évidence, de nombreuses lectures savantes. En vérité, on peut penser qu’il n’a jamais cessé de l’entretenir. L’épisode de sa vie au cours duquel il a accepté de réécrire l’évangile selon Marc pour la Bible de Bayard a dû compter autant dans sa détermination à remettre sur le métier cette ample réflexion sur les débuts du christianisme et sur Jésus. Pour enfin payer la dette que tout écrivain doit aux Écritures ?
Ancien journaliste dont le style a gardé de ce premier métier la nécessaire « ligne claire », Emmanuel Carrère a toujours eu un double goût : celui de la vie des autres et celui de l’enquête. Son livre devait d’ailleurs s’appeler L’enquête de Luc car c’est de cet évangéliste qu’il tente de reconstituer le parcours. C’est dans ce Luc rencontrant Paul et racontant dans les Actes des apôtres cette rencontre et les premiers temps de ce qui n’est pas encore l’Eglise, puis écrivant la vie de Jésus, que va se projeter l’écrivain et scénariste Carrère pour sa tentative de reconstitution d’une genèse du Nouveau Testament et de cette religion nouvelle dont Renan, que Carrère admire, dira : « L’Église, c’est une secte qui a réussi ».
Imaginer Luc au travail sera pour Carrère la seule façon de conjuguer rationnellement Paul, inventeur d’un christianisme hors l’Histoire – on pourrait dire « hors sol » - puisque précédant l’écriture des évangiles et même, à la limite, les ignorant, avec la figure de son fondateur, Jésus, obscur prophète galiléen, dont la mort ignominieuse sur une croix romaine aurait dû disperser définitivement la personne, les enseignements et les disciples dans la nuit de l’oubli. Luc est le go-between, le pont idéal entre Jésus et Paul et Carrère va brosser habilement son parcours d’auteur en profitant des silences des textes et de l’Histoire.
Paul enseigne que la sagesse du monde est folie devant Dieu et que Dieu a choisi ce qui était faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Ce qu’entendent les correspondants des épîtres de Paul est, pour Carrère, « quelque chose d’absolument nouveau » (271) dans le monde antique, à l’instar du fameux « les premiers seront les derniers » (et inversement). Carrère confronte in fine la figure et l’enseignement de Paul à ceux d’Ulysse, qui a refusé la proposition de Calypso, « que plus personne ne nous fait », note-t-il avec une pointe de regret (293) : une éternité d’amour avec une femme éternellement jeune. Or, la proposition de Calypso, dit Carrère, présente une « ressemblance troublante » avec celle de Paul : être délivré de la vie et de sa chair dégradable, de l’ici-bas, de la condition d’homme. Pour Carrère, il y a deux familles humaines : celle des hommes qui aiment la vie sur terre et n’en veulent pas d’autre : et « celle des inquiets, des mélancoliques, de ceux qui croient que la vraie vie est ailleurs. » (294). Il ne semble pas voir que les chrétiens, comme les autres et de toutes les époques, se partagent entre ces deux familles et sont même intimement déchirés entre elles.
Dans l’enquête entamée au chapitre suivant, va émerger progressivement l’idée que peut-être, ces deux familles finiront par se réunir et pourront se dire enfin, comme les pèlerins d’Emmaüs, « que la tristesse, c’était fini » (342), cette tristesse dont on ne peut pas ne pas penser, en relisant toute l’œuvre de Carrère, qu’elle lui colle à la peau.
Le doute final qu’éprouve Carrère concerne sa propre fidélité au croyant qu’il a été et qu’il n’est plus. Il vise en cela, peut-être, « la figure secrète de la vie de chacun » (152), donc de la sienne et celle de son lecteur. Pourtant, ce doute a semblé s’effacer dans les dernières pages où il décrit sa rencontre avec Jean Vanier et la communauté de l’Arche. C’est là qu’il nous fait entrevoir le mieux la vérité du Royaume, celui dont Jésus annonce à ses disciples qu’il est « parmi nous », hic et nunc. Lorsqu’Elodie, la jeune trisomique, se plante devant Emmanuel et l'entraîne dans une danse et dans un chant auquels il répugnait à se joindre l’instant d’avant, c’est que quelque chose en lui vient de céder. Ce quelque chose, il en a fait la description exacte cinq cents pages auparavant en évoquant la conversion de Saul : « tout ce qui sépare les hommes les uns des autres avait disparu et tout ce qui les sépare du plus secret d’eux-mêmes. » (172) N’est-ce pas cela, le Royaume, n’est-ce pas Elodie qui conduit enfin Emmanuel « là où tu ne voulais pas aller » (Jean 21,18, cité deux fois, p. 53 et p. 611), là où l’on danse, enfin ?
***
Les exégètes professionnels dénonceront sans doute dans le dernier livre de Carrère des erreurs et des approximations, non moins que d’audacieuses hypothèses, largement puisées dans l'œuvre de l'écrivain juif anglais, Hyam Maccoby. Critiques d'autant plus dures qu’ils ne pourront que jalouser la clarté de l’exposé et sa sincérité.
Il y a tout de même dans ce livre quelques « ratés ». La synthèse sur les « ruptures » de Jésus (477-478) prête au prophète galiléen, notamment vis-à-vis des femmes, des opinions que l’on trouve peut-être chez Paul ou dans la hiérarchie catholique, mais pas dans les évangiles ! Où Jésus dit-il qu’il ne faut pas prendre femme, ne pas désirer, ne pas avoir d’enfants, et surtout qu’il faudrait préférer « le deuil, la détresse, la solitude, l’humiliation » ? Nulle part, il me semble. Chez Nietzsche, peut-être…Jésus est un "bien-vivant", pas un Cathare. Le prochain livre d'André Paul, Éros enchaîné (Albin Michel), fera d'ailleurs litière de ces vieilleries. Par ailleurs, d’où Carrère tient-il qu’une partie des premiers chrétiens se serait transformée « sous l’autorité de Jean en secte fanatique » (520) « d’ésotéristes paranoïaques » (534) ? Ce n’est pas ce qui ressort de l’évangile du disciple que Jésus aimait, même si on peut sourire que le dit disciple (ou son scribe tardif) revendique cette préférence du maître pour lui, ou qu’il se mette lui-même en scène comme le dernier des hommes fidèles au pied de la croix.
Le Royaume n’est pas un traité aride. La personne et la sensibilité de l’auteur, celles de sa femme, de ses amis, leur vie quotidienne, sont constamment mêlées à l’œuvre en train de se faire et c’est ce qui fait une grande partie de son charme et au-delà, de sa force vitale. Pour autant, on s’étonnera de voir surgir au détour d’un commentaire d’un tableau de van der Weyden, représentant Luc l’évangéliste en train de peindre la Vierge, la description minutieuse d’une vidéo pornographique qui a eu l’heur d’enchanter notre auteur lors d’une de ses retraites valaisanes et qu’il a fait partager à son épouse - c'est un couple libre sous tous rapports (390-397, ceux que ça intéresse pourront y aller directement). Qu’est-ce que ça vient faire là ? J’ai envie de tutoyer M. Carrère pour l'occasion : c’est ta life et on s’en fout, comme de savoir que tes mains ne sont pas toujours posées sur le clavier de ton ordi. Laisse ça à Valérie Trierweiler.
Comme Emmanuel Carrère y est invité jeudi prochain, je regarderai sans doute La Grande Librairie, puisque mon ami Jean me l'a conseillé. Comme c'est une question du niveau de notre télévision, je saurais peut-être alors si ce morceau choisi est une provocation mûrement réfléchie à l’intention des cathos coincés qui liront le livre, une exhibition de dernière minute pour éviter d’être affublé par l’Eglise d’un imprimi potest, une façon de se soulager un instant d’un sujet trop sérieux, ou un malencontreux copier-coller qui aurait échappé à la relecture, comme le « Pélopponèse » (sic) de la page 327.